Saint Luc (vers 1624-1626), Valentin de Boulogne (1591-1632),
En juillet 2023, s’achevait au château de Versailles l’exposition Chefs-d’œuvre de la chambre du roi. L’écho du Caravage à Versailles. Ceux qui n’eurent pas la chance de la voir peuvent lire le catalogue dirigé par Béatrice Sarrazin, et découvrir certaines des œuvres qui n’ont jamais quitté l’attique de la chambre du roi.
« Le plus italien des caravagesques français »
Au cœur de l’appartement royal, et au centre de la cour de marbre, le « salon où le roi s’habille » reçoit lors de sa création, en 1684, neuf tableaux attestant le goût de Louis XIV pour la peinture caravagesque, tous disposés à l’attique, c’est-à-dire au niveau supérieur des murs : des œuvres de Valentin de Boulogne, Nicolas Tournier (1590-v. 1638), Alessandro Turchi (1578-1649) et Giovanni Lanfranco (1582-1647). Lorsque la pièce est transformée en chambre, en 1701, seuls les quatre évangélistes, le Denier de César par Valentin de Boulogne et Agar et l’ange par Giovanni Lanfranco sont conservés in situ. Saint Matthieu, Saint Luc, Saint Jean et Saint Marc, aujourd’hui encore exposés au même endroit, constituent un ensemble cohérent. Le Saint Luc était autrefois placé en regard du Saint Jean, et faisait face au Saint Marc, sur le mur nord, assurant ainsi une continuité chromatique qui fut modifiée en 1948-1949 lors d’un nouvel accrochage qui plaça le Saint Matthieu en pendant du Saint Luc.
Valentin de Boulogne, « le plus italien des caravagesques français » pour reprendre l’expression de Béatrice Sarrazin, y démontre sa dette envers le Caravage (1571-1610) tout autant que sa capacité à élaborer un langage personnel, « empreint de gravité et de mélancolie ». Né à Coulommiers, le peintre arrive sans doute à Rome dès 1609. Avec Nicolas Régnier (v. 1588-1667), il fréquente la Bent, une société secrète d’artistes transalpins, les Bentvueghels ou « oiseaux de bande », placés sous l’égide de Bacchus, le dieu du vin. Ils représentent volontiers les bas-fonds de Rome, c’est-à-dire la Rome « du vice et de la misère », celle des tavernes et des faubourgs, et développent un art souvent irrévérencieux et satirique mêlant érotisme et morale. Valentin côtoie également d’autres artistes français, notamment Simon Vouet (1590-1649), qui joua un rôle décisif dans le renouvellement de la peinture française. Après les scènes de genre qui constituent une large part des premières années de sa production, il s’intéresse à la peinture religieuse. La série des quatre évangélistes, dont les compositions de format horizontal s’équilibrent par un jeu de répons, repose sur un schéma identique : chaque Apôtre, accompagné de son attribut, est représenté sur un fond neutre et sombre, assis à une table, comme s’il était saisi lors de l’écriture de son Évangile. Réduite à l’essentiel, l’iconographie permet de concentrer le regard du spectateur sur la personnalité des évangélistes et « traduit magistralement l’inspiration divine ».
La douceur de Luc
C’est sans doute la douceur qui caractérise Luc, représenté avec le taureau qui lui est traditionnellement associé. Sur la table où il s’applique à écrire, l’on aperçoit une Vierge à l’enfant. Ce tableautin rappelle que l’Apôtre fut, selon la tradition, le premier à écrire – c’est le terme consacré – une icône de la Vierge, devenant ainsi le saint patron des peintres. Valentin de Boulogne fait le choix de le peindre jeune, plongé dans l’écriture de son Évangile, tenant fermement l’encre dans sa main gauche et la plume, de sa main droite. L’utilisation savante du clair-obscur et de la gamme chromatique – dont les subtilités tonales ont été retrouvées lors d’une récente restauration – concentre le regard sur l’expression de son visage, sur ses mains et sur le manuscrit. L’on sait peu de choses de saint Luc, qui serait un Grec né, d’après saint Eusèbe, à Antioche, en Syrie, et que l’épître aux Colossiens (cf. Col 4, 14) cite comme « médecin ». Fêté le 18 octobre dans le rite catholique et orthodoxe, ce médecin bien-aimé (Col 4, 14) écrit l’un des quatre Évangiles, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début (Lc 1, 3), mais aurait également été le compagnon de saint Paul, qu’il accompagne jusqu’à Rome, et le rédacteur des Actes des Apôtres. Remarquable conteur, Luc manifeste de manière particulière la tendresse et la miséricorde de Dieu : il est le seul à rapporter, par exemple, les paraboles du bon Samaritain et du fils prodigue, la rencontre de Jésus et de Zachée, le dialogue de Jésus et du bon larron (Dismas), qui nous plongent au cœur de l’amour infini de Dieu. « Chantre de la mansuétude du Christ », d’après Dante, Luc nous permet de mesurer l’amour de Dieu pour l’humanité égarée et blessée par le péché. Historien, attaché à la précision du récit des événements qu’il adresse à Théophile, c’est-à-dire en réalité à tous les « amis de Dieu », pédagogue qui souhaite que son lecteur se rend[e] bien compte de la solidité des enseignements […] entendus (Lc 1, 4), Luc est aussi un théologien qui s’émerveille de la miséricorde divine et met en lumière, de manière particulière, le rôle de l’Esprit Saint à l’œuvre dès les commencements, tant dans la vie du Christ que dans celle des premières communautés chrétiennes.
Que la contemplation de ce saint patron des peintres et des médecins, tel que le représenta Valentin de Boulogne, abîmé dans l’écriture de son Évangile, le visage empreint de douceur, nous encourage à plonger dans la lecture des récits lucaniens, afin de nous émerveiller de l’action de Dieu dans nos vies et de son infinie miséricorde.
Sophie Mouquin
Maîtres de conférences en histoire de l’art moderne à l’université de Lille.
Pour aller plus loin
– Béatrice Sarrazin (dir.), Chefs-d’œuvre de la chambre du roi, Paris, In Fine – château de Versailles, 2022.
– Keith Christiansen et Annick Lemoine (dir.), Valentin de Boulogne. Réinventer Caravage, cat. exp. New York et Paris, 7 octobre 2016 au 22 mai 2017, Paris, Officina Libraria – Louvre éditions, 2017.
– Henry de Villefranche, Voir et servir. Des clés pour lire saint Luc, Paris, Parole et Silence, 2018.
Saint Luc (v. 1625), Valentin de Boulogne (1591-1632), châteaux de Versailles et de Trianon, Versailles. © GP-RMN (Château de Versailles) / Christophe Fouin.







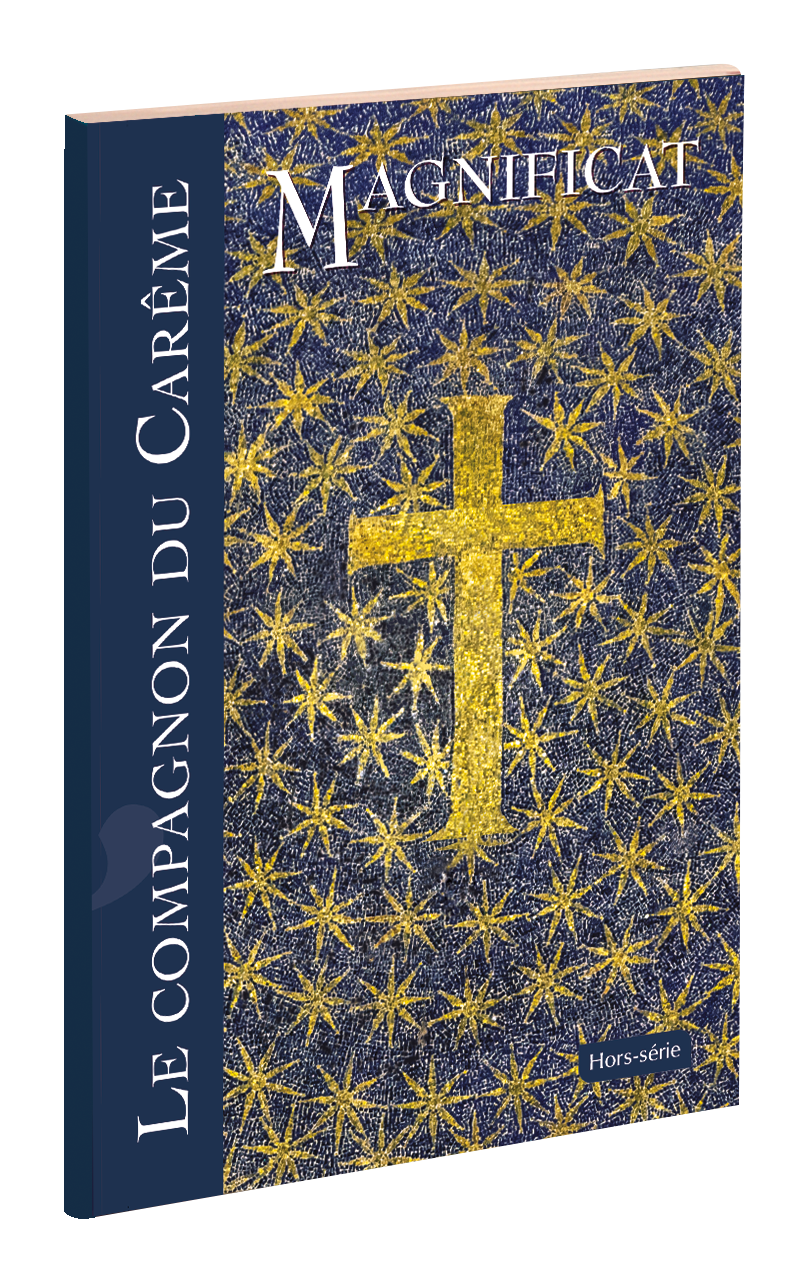
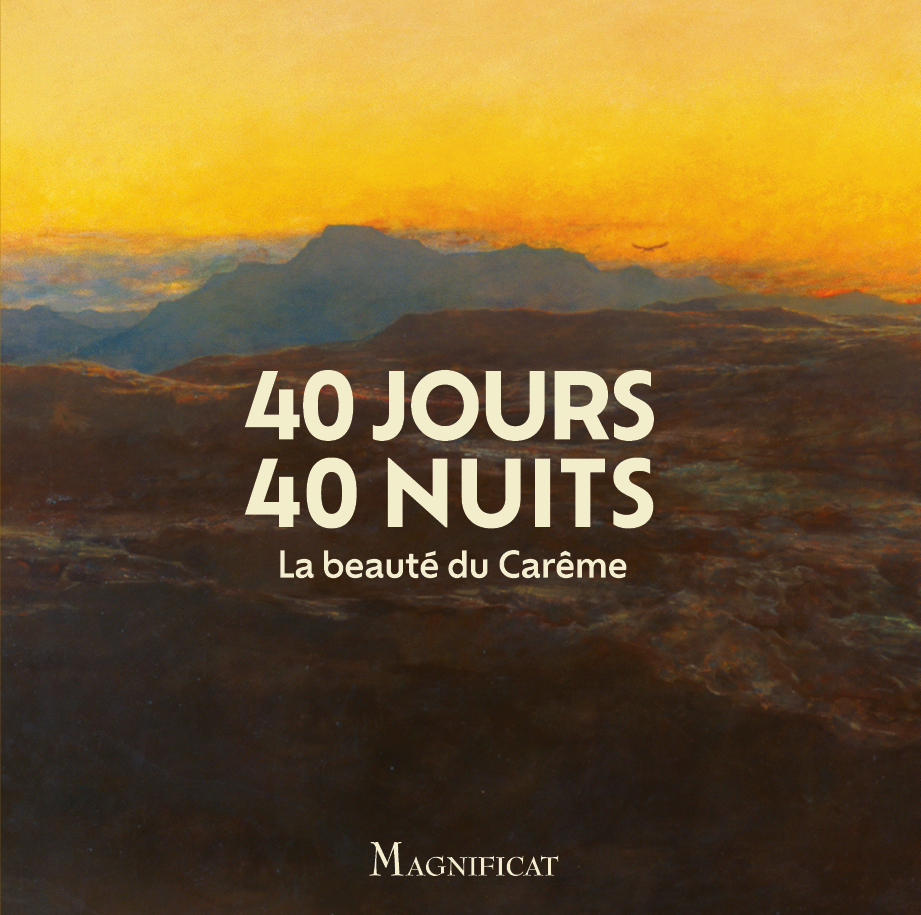


Autres commentaires