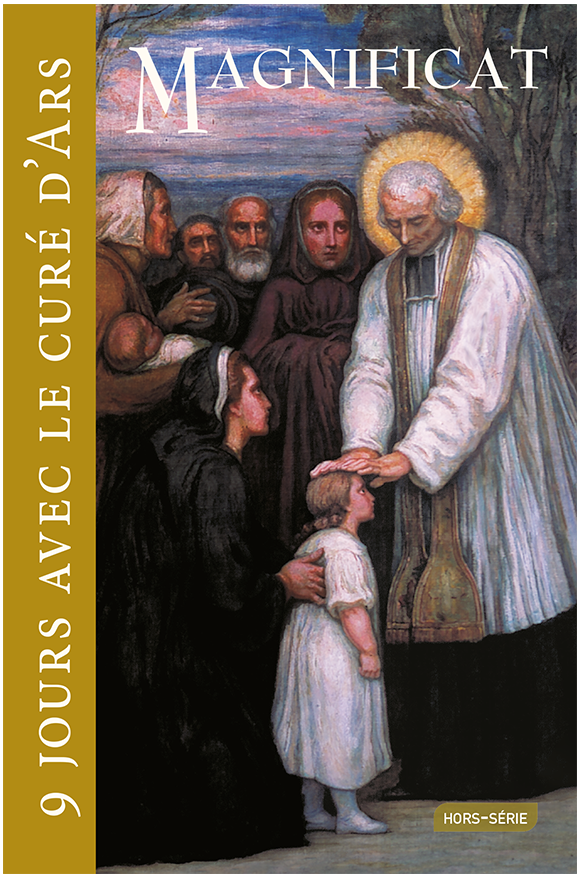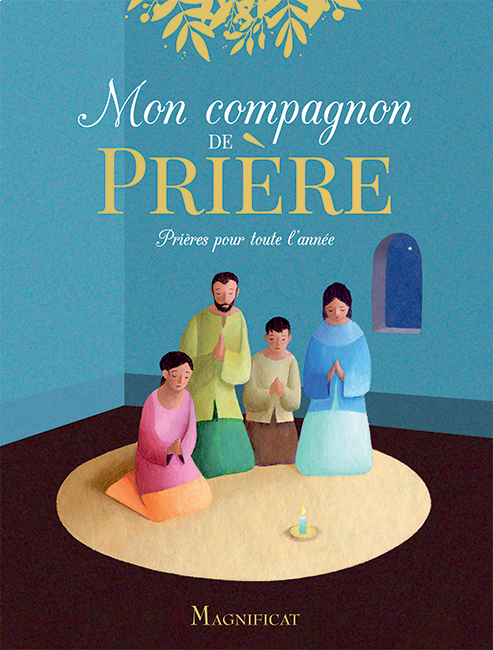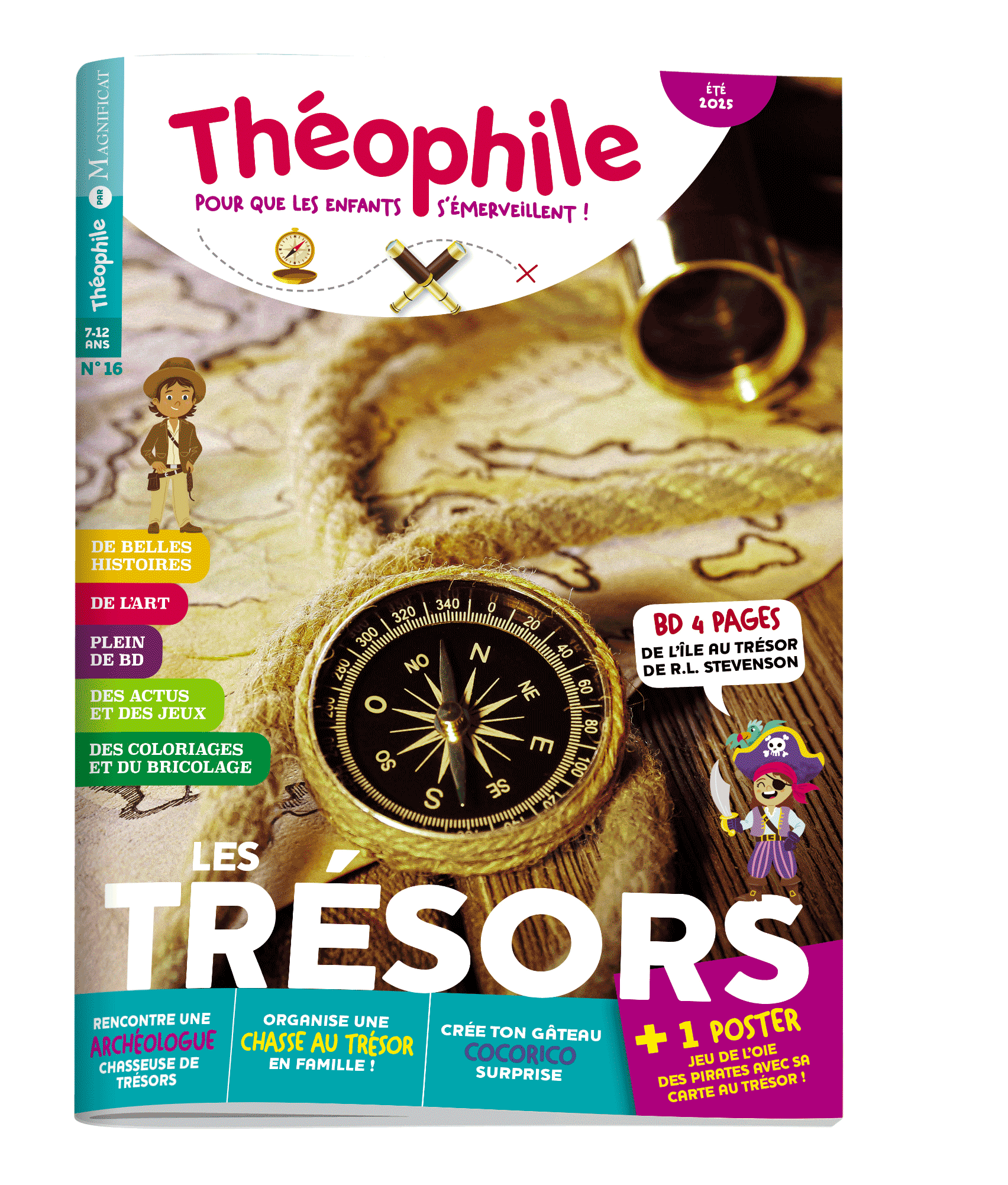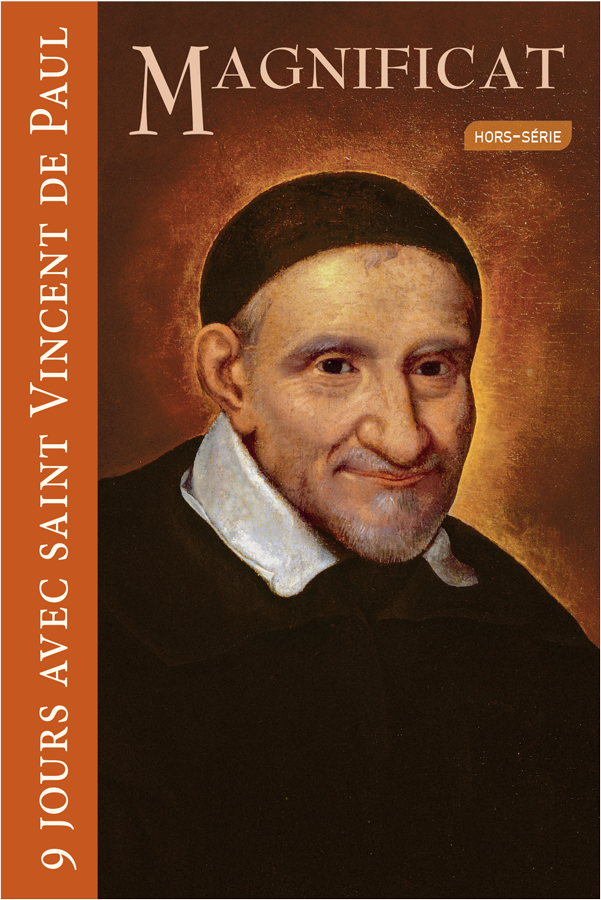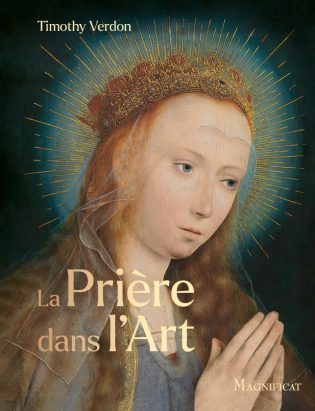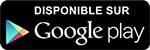En proposant aux communautés chrétiennes un dimanche de la santé, l’Église invite les chrétiens à porter attention à ceux qui souffrent d’une altération de leur santé comme à celles et ceux qui les soignent. Depuis toujours attentive à ses membres souffrants, l’Église prend en compte le mal et la souffrance de plusieurs manières, et plus particulièrement par les sacrements, signes du salut. En effet, « salut » et « santé » sont étroitement liés par une même étymologie. Que propose donc l’Église pour accompagner les malades ?
Le Christ face à la souffrance
Lorsque le Christ est confronté à une souffrance humaine (maladie, handicap, mort, souffrance morale), son attitude est toujours la même. Il prend en compte l’humanité souffrante de la personne, lui donne attention, considération et, par des gestes et des paroles de guérison, la réintègre dans la société dont la maladie l’avait exclue. Jésus, en se faisant proche de la personne souffrante, commence toujours par la « réhumaniser ». Il sait que la maladie entraîne une forme de mort sociale pouvant aller jusqu’à l’exclusion. Cette attitude nous invite à penser « humanisation » avant « sacramentalisation » ; la pastorale induite par le rituel des sacrements pour les malades en est une belle illustration.
Cependant, le Christ ne se contente pas de se faire proche des malades. Il remet debout ceux que la souffrance a jetés à terre : « Lève-toi » ; « Va, ta foi t’a sauvé ». La parole qui accompagne le geste de guérison est une parole de résurrection. Remettre debout, sur le chemin de la vie, l’être humain dégradé par la maladie et la souffrance, c’est lui redonner sa dignité. Et le Christ lie souvent la guérison physique à une guérison intérieure faite de confiance, d’espérance et de renoncement à ce qui dégrade l’homme.
La tradition de l’Église
La tradition de l’Église donne des témoignages sur l’onction des malades : L’un de vous est malade ? Qu’il appelle les Anciens en fonction dans l’Église : ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur. Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade : le Seigneur le relèvera et, s’il a commis des péchés, il recevra le pardon (Jc 5, 14-15). Fidèle à la manière du Christ, (cf. Mc 2, 1-12 ; Jn 5, 14 ; Ac 10, 38) l’Église apostolique fait de l’onction des malades un geste de guérison corporelle et spirituelle. Maladie et péché sont liés ; l’un et l’autre enserrent l’homme pour le mener à la mort physique et spirituelle. Guérir, c’est faire œuvre de vie ; pardonner les péchés aussi. Au cours des siècles, la pratique de l’Église va évoluer de différentes manières et, pour diverses raisons, beaucoup de chrétiens vivront l’extrême-onction comme une condamnation à mort. Ce faisant, on prive le malade d’un sacrement dont il aurait eu besoin pour mieux vivre sa maladie. Le concile de Trente tentera de réhabiliter le sacrement des malades ; en vain. Il faudra attendre Vatican II pour qu’un nouveau rituel soit donné.
La communauté chrétienne et les malades
Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance (1 Co 12, 26). Dans l’Église, Corps du Christ, personne ne peut rester indifférent à la souffrance de l’autre. Aussi la place de la communauté chrétienne est-elle essentielle dans la pastorale des malades, et ce depuis les débuts de l’Église. Le souci des malades est une expérience unique du Corps du Christ, corps solidaire et fraternel des baptisés. Ce souci se traduira de plusieurs façons, mais plus particulièrement par des visites fraternelles, par la prière et l’apport de la communion eucharistique, si le malade la désire. La réserve eucharistique, avant d’être un lieu de prière personnelle et d’adoration, est le rappel permanent que l’Église n’oublie jamais ses malades. C’est d’abord pour porter l’eucharistie aux malades et aux mourants que le tabernacle trouve sa place dans nos églises.
Une présence et des sacrements
L’intitulé du rituel le dit clairement : il n’y a pas un seul sacrement, mais des sacrements pour les malades. Ces sacrements sont proposés selon un itinéraire apte à accompagner le malade, en fonction de son cheminement personnel et pendant toutes les étapes de sa maladie. Ce compagnonnage humain et spirituel commence par la visite des malades, visite gratuite dont le but est de maintenir ou de revitaliser des liens humains que la maladie a distendus. Ces visites peuvent soutenir la foi et l’espérance du malade. Elles permettent de lui proposer des temps de réflexion, de prière, et de conserver un lien avec la communauté.
Vient ensuite la communion portée au malade. Il ne s’agit pas seulement, de la part du malade, d’un geste de piété personnelle ; il s’agit d’un geste d’union au Christ et à une communauté célébrante qui vient le rencontrer pour lui porter la Parole et le pain de vie que l’assemblée a partagés.
Comme une troisième étape, le rituel propose l’onction des malades. Il ne s’agit plus d’extrême-onction mais d’un sacrement, marqué par l’imposition des mains et l’onction d’huile, qui aidera le malade à mieux vivre sa maladie ou les étapes d’une santé déclinante. Ce sacrement fortifie la foi et l’espérance que la maladie, la souffrance, la solitude peuvent mettre en péril. Il ne s’agit en aucun cas d’un remède surnaturel qui viendrait concurrencer les soins de la médecine, mais d’un sacrement dont la demande manifeste le désir de recevoir la force du Christ pour affronter la maladie. Désormais, il est rare que le malade qui va recevoir ce sacrement ne soit pas entouré de membres de sa famille, d’amis ou de la communauté chrétienne. L’Église donne ainsi plus de visibilité à la fraternité et à la prière communautaire.
À travers la célébration du sacrement, c’est l’Église de la terre unie à l’Église du ciel qui prie pour les malades.
Lorsque l’heure vient de vivre le passage en Dieu, l’Église offre à ceux dont la vie s’éteint le viatique, communion au corps et au sang du Christ, semence de vie éternelle et puissance de résurrection (cf. Jn 6, 54). Le chrétien s’unit ainsi au Christ dans son mystère pascal et, confronté à la mort, se voit offrir le même chemin : passer de la mort à la vie éternelle. La façon dont la fin de vie est aujourd’hui prise en charge permet de reconsidérer le viatique et de le proposer lorsque le malade est encore conscient. Le sacrement l’aidera à cheminer dans la foi, à assumer sa mort avec et dans le Christ. La prière de recommandation auprès du mourant est un dernier témoignage d’amour donné : celui d’une présence fraternelle et d’une prière confiante.
Toutes ces propositions de l’Église montrent bien son attention et sa sollicitude pour les malades. Elles sont autant de gestes de tendresse et de foi pour tous ceux qui souffrent. Adaptés aux situations personnelles et à leur évolution, les sacrements des malades offrent un itinéraire tissé de relations, qui évite au souffrant de s’isoler dans sa propre souffrance. Ils permettent un dialogue d’alliance renouvelé ou raffermi entre les malades, Dieu et la communauté. Et quand la souffrance étouffe les mots, l’Église les donne au malade pour s’adresser à Dieu. Par ces sacrements, l’Église se fait proche de tous ceux qui souffrent, les accompagne vers un supplément d’humanité et de spiritualité. Elle est alors signe de salut et ouvre un chemin de vie avec le Christ.
@MGF no 351, février 2022