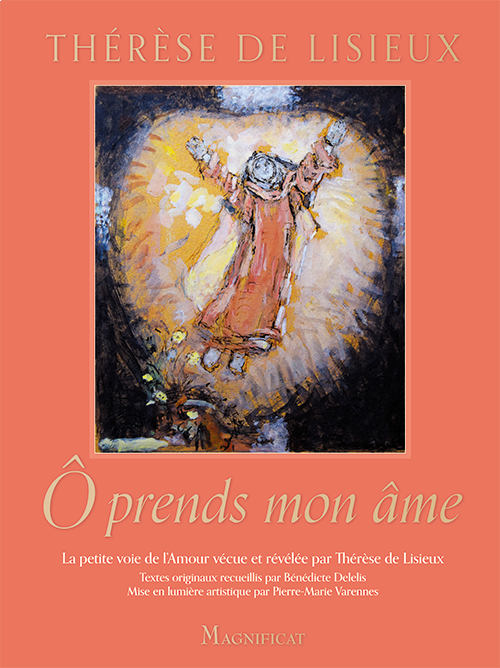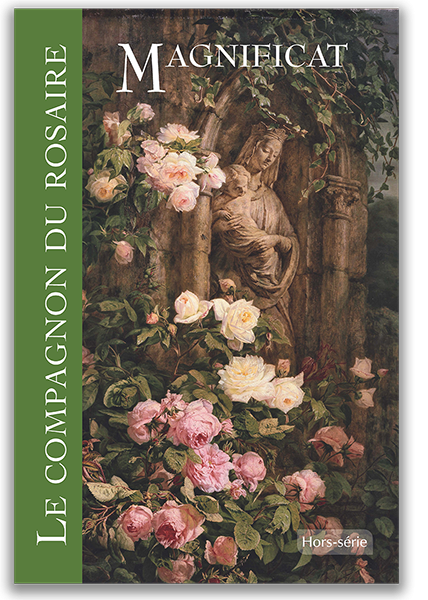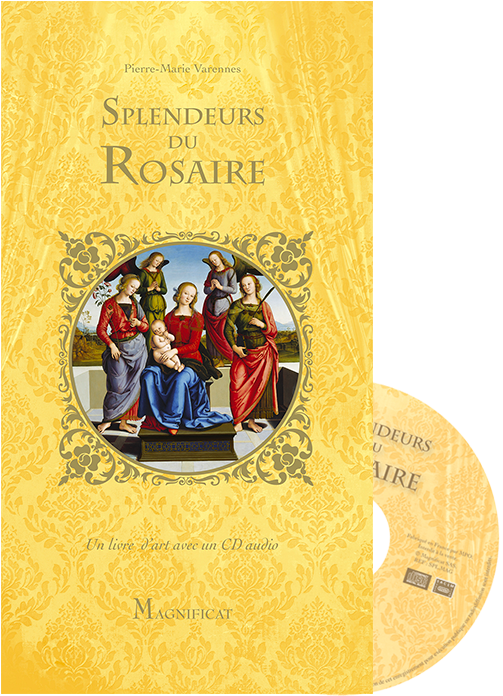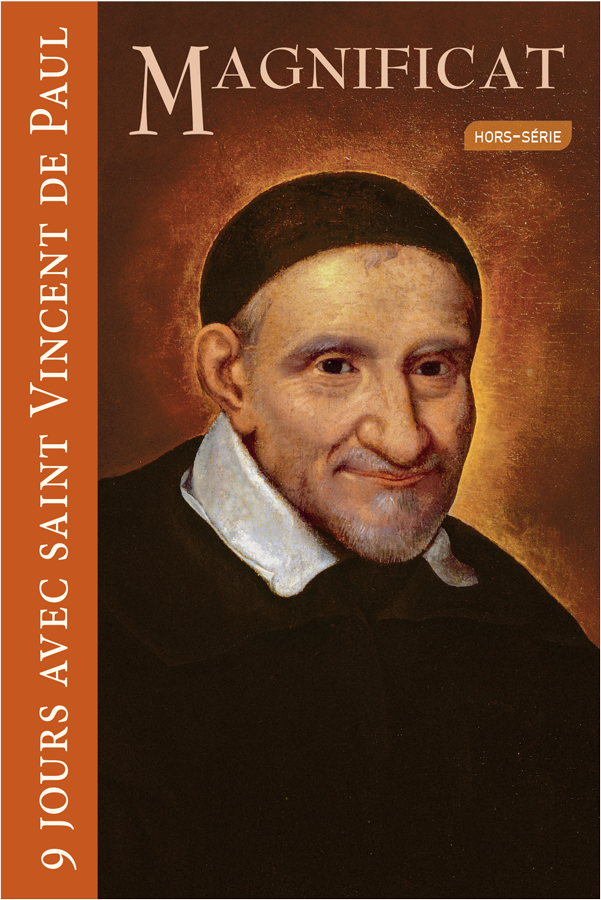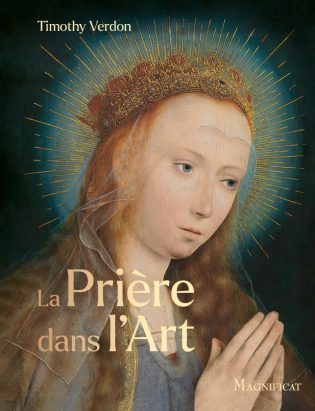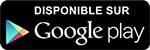Le Carême est le temps par excellence de la conversion. Tout dans la liturgie y invite. Le dépouillement qu’elle préconise veut contribuer, par la médiation des rites et des formes, à un recentrement spirituel. Si le Carême doit être sobre, c’est plus largement toute la liturgie, au long de l’année, qui est appelée à « ne pas trop en faire » pour aller à l’essentiel et demeurer dans la justesse, même solennelle. On est frappé de constater que le mot « sobriété » n’apparaît en tout et pour tout qu’une seule fois dans l’ensemble des textes conciliaires au moment de parler, dans la constitution sur la liturgie, de la profession religieuse (1) ! Pourtant, le Concile énonce un principe fondamental qui guidera la restauration de la liturgie : « Les rites manifesteront une noble simplicité, seront d’une brièveté remarquable et éviteront les répétitions inutiles ; ils seront adaptés à la capacité de compréhension des fidèles et, en général, il n’y aura pas besoin de nombreuses explications pour les comprendre (2). »
Sans que la sobriété soit explicitement nommée, on comprend d’emblée que la « noble simplicité » l’inclut. La sobriété devient ars celebrandi, art de célébrer. La sobriété rend service à la liturgie : elle lui permet d’être ce qu’elle est. Elle participe, comme l’indique à la fois son sens latin et français, à sa tempérance, à sa retenue et à son dépouillement.
La tempérance
Déjà, selon Platon, la tempérance assure la maîtrise de la volonté sur les instincts et maintient les désirs dans les limites de l’honnêteté, procurant l’équilibre dans l’usage des biens (3). En régime chrétien, le groupe de quatre vertus cardinales – tempérance, prudence, justice et courage – est complété par trois autres vertus dites « théologales » – foi, espérance et charité – qui les perfectionnent. Les vertus humaines acquises par l’éducation, par des actes délibérés et par une persévérance toujours reprise dans l’effort, forgent, avec l’aide de Dieu, le caractère et donnent une aisance dans la pratique du bien. Elles disposent toutes les puissances de l’être humain à communier à l’amour divin.
Parler de tempérance comme d’une vertu pour la liturgie, ce n’est pas assigner à cette dernière un but qu’elle n’a pas à atteindre. En soi, la liturgie est vertueuse ! Par contre, celui qui la célèbre – quel que soit son ministère ou sa place dans l’assemblée – a besoin de se rappeler qu’il doit faire œuvre de tempérance. Sans tempérance, la liturgie risque d’être détournée à des fins particulières, pour des goûts personnels ou des options idéologiques, comme la projection de nos propres ambitions. On pourrait repérer ici les dangers liés à une trop grande liberté par rapport aux livres liturgiques et aux rituels. Plus que d’entraver la liberté et de bannir la créativité, ils garantissent une heureuse distance entre mes désirs d’investir la liturgie et le projet propre qu’a la liturgie – donc Dieu ! – pour moi. Il est bon de rappeler aussi que la diversité de choix qu’ils proposent honore l’heureuse volonté que les mots de la célébration rejoignent bien un peuple concret et déterminé de croyants.
La retenue
Si la sobriété est tempérance dans la maîtrise de soi, elle implique donc aussi une retenue. En liturgie, la retenue est gage de sacramentalité. Pour que fonctionne l’échange symbolique, il faut prendre de la distance. Chaque acteur de la liturgie doit veiller à ne pas se laisser prendre à son propre jeu, à ne pas déraper. Son ministère dans la liturgie ne vise pas à se répandre, à imposer sa subjectivité à toute l’assemblée, mais, au contraire, à s’effacer pour que le Christ puisse se rendre présent, pour qu’il se révèle pleinement à travers les gestes, les paroles et les chants.
Un surinvestissement de son rôle liturgique peut devenir nocif dans la mesure où il ne renvoie qu’à soi mais non plus à celui qui est l’origine et le but de la célébration, le Christ. Cette retenue se vit dans l’attention à la parole et au ton de voix. Trop souvent, ceux qui ont à prendre la parole durant les célébrations haussent leur timbre de voix et font saturer l’espace par le truchement d’une mauvaise utilisation des moyens de sonorisation. Ils imposent à l’assemblée une véritable domination auditive. Il arrive encore que les déplacements ou les gestes, les postures du corps prennent une telle emphase qu’il est impossible de percevoir que leur vocation première est de renvoyer à Dieu. Là encore, c’est une prise de possession physique de l’espace liturgique, vécue dans la gesticulation. La retenue, sans devenir repli sur soi ni oubli de la corporéité, permet de donner du relief à la célébration. Ce relief suivra celui de la structure liturgique elle-même. Il n’y aura nul besoin de « trop en faire » : la liturgie indiquera elle-même le chemin à emprunter.
Le dépouillement
Parler de dépouillement en liturgie ne revient pas à parler de misérabilisme liturgique, ou d’une espèce de paraître délibérément entretenu pour « faire pauvre ». Il s’agit avant tout d’une posture spirituelle éminemment pascale. Il ne s’agit pas tant de dépouiller la liturgie que de se dépouiller soi-même. Chose exigeante et difficile. C’est une manière de vivre au cœur même du mystère de foi le cantique aux Philippiens, qui, lu au seuil de la Semaine sainte, en sera comme la clé de compréhension : Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté (Ph 2, 5-9). L’extrême dépouillement réalisé ici et là à la suite de la réforme liturgique n’a de sens que s’il est traduction du dépouillement vécu spirituellement, afin que Dieu y agisse, comme il l’a fait pour Jésus dans le mystère de sa Pâque. Ce dépouillement est tout compte fait un vide plein de la présence de Dieu, il est recentrement acharné sur l’essentiel. En liturgie, corps et esprit ont à s’y exercer pour que les chrétiens retrouvent la saveur de prier au rythme de l’Église.
Il sera heureux que cet entraînement à l’essentiel puisse fixer le regard sur une seule croix, ne soit pas troublé par plusieurs représentations de la Vierge Marie dans un périmètre restreint, donne à cerner combien – par exemple – la table de la Parole et celle de l’eucharistie sont distinctes et pourtant inséparables. L’expérience tend à montrer que chaque fois qu’on s’efforce, par fidélité à l’Église, « de coller au réel », c’est-à-dire de cerner au plus près le mystère qui s’accomplit, on imprime de surcroît à toute l’assemblée son véritable mouvement humain. La sobriété se traduit en posture spirituelle et porte les fruits de grâce espérés.
L’enthousiasme qui a accompagné la mise en œuvre de la réforme de la liturgie ne suffit pas. La volonté de sobriété a en effet rendu les choses plus complexes et plus délicates. Quand l’accessoire tend à disparaître, l’essentiel se révèle plus fragile.
En s’effaçant, les acteurs de la liturgie feront preuve de maîtrise d’un art de célébrer. En s’effaçant, ils laisseront Dieu agir à travers eux, dépossédés d’eux-mêmes. En s’effaçant, ils se dépouilleront comme le Christ, et ainsi sera rendu présent le mystère pascal. C’est là tout l’enjeu de la sobriété en liturgie.
« Regard sur la liturgie », MGF 304, mars 2018
1. Vatican II, Sacrosanctum concilium, n° 80.
2. Idem, n° 343. Cf. Platon, Gorgias, 493d-494a, et idem, La République, Livre IV, 430e-431b.