Saint Jacques (1520), Jacopo Sansovino (1486-1570)
Saint Jacques, fils du tonnerre
Cette noble statue, toute de blancheur et d’or, de saint Jacques le majeur se trouve à l’église Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli, à Rome. Elle est aux Espagnols ce que Saint-Louis-des-Français est pour nous. Une église nationale, dans le cœur de la cité sainte. C’est l’une des églises choisies pour le jubilé 2025. Elle a pour origine la générosité de deux femmes : la Catalane Jacoba Ferrandes qui fonde l’hospice San Niccolò di Catalani, en 1354, pour les pèlerins de la couronne d’Aragon. Et Margarita Pauli de Mallorca, qui fonde peu après l’hospice Santa Margarida di Catalani dédié aux femmes, en 1363. C’est le pape Alexandre VI qui réunit les deux hospices sous le patronage de Notre-Dame de Montserrat. En 1506, est élevée l’Església de santa María de Montserrat sur l’ancienne chapelle de San Niccolò. Les travaux commenceront en 1518, et seront interrompus de nombreuses fois pour des questions de financements. Mais la ténacité espagnole aura eu raison de toutes les difficultés et l’église recèle des trésors dont cette statue de saint Jacques le majeur.
Elle est l’œuvre de Jacopo Sansovino. Né Jacopo Tatti, l’artiste a pris le nom de son maître en signe d’hommage et de fidélité. Il est à la fois sculpteur et architecte. Il fuit le sac de Rome, en 1527, pour Venise où il se fixe définitivement. Ni le pape ni le roi mécène François Ier n’arriveront à le convaincre de quitter la Sérénissime. Il y travaillera notamment au réaménagement de la place Saint-Marc, tout en continuant son œuvre de sculpteur, ornant la logetta du campanile de bas-reliefs et de statues en bronze. Il fera autorité en Italie par le double don de savoir allier les styles romain et vénitien, l’architecture et la sculpture.
Une représentation a priori classique
Nous voici donc devant son Saint Jacques le majeur. Si la statue est belle, elle semble pourtant convenue. On le reconnaît facilement à ses attributs traditionnels que sont les coquilles qui ornent son vêtement et son bourdon de pèlerin. Mais il tient aussi un livre. Si l’on demande à ChatGPT pourquoi le saint porte ce dernier élément, le robot répond : « Il est possible que vous ayez vu une représentation inhabituelle ou que vous confondiez saint Jacques avec un autre saint. » Charge donc à un esprit humain de tirer des conclusions non mécaniques de ce fait « inhabituel ». Jacques le majeur est le fils de Zébédée, il est dit majeur par comparaison à Jacques le mineur, fils d’Alphée. Et c’est le frère… de saint Jean. Sansovino, à mon sens, décide donc de souligner cette fratrie dans sa sculpture en modulant les attributs hagiographiques classiques. Jacques était l’aîné de Jean. Il porte l’ouvrage décisif de son frère qui grave à jamais l’une des plus singulières histoires du monde : celle de Jésus. À qui il ressemble beaucoup – si tant est que l’on puisse discerner les traits divins. Mais quelque chose de christique se dégage de son visage. Si Jacques n’écrit pas contrairement à Jean, le pêcheur assiste à nombre de scènes majeures : la résurrection de la fille de Jaïre, la transfiguration, la prière au jardin des Oliviers, la seconde pêche miraculeuse après la Résurrection. C’est peut-être cette proximité qui fait sculpter à Sansovino ces traits christiques, configurés à ceux de Jésus.
Jacques et Jean comme Marthe et Marie
Au fond, Jacques et Jean sont les équivalents masculins de Marthe et Marie. Le contemplatif et l’actif. L’introverti et l’extraverti. Jean et Marie d’un côté, tout absorbés dans la contemplation du Maître, Marthe et Jacques de l’autre, pris d’irrépressible élan à agir, à faire, à… évangéliser. Ce sera le destin de Jacques, ce que son frère a écrit dans un livre d’éternité, il le porte dans son âme, et cela le pousse à aller de par le monde. On se souvient moins que, grand saint patron de l’Espagne, il vécut en réalité… un échec cuisant. Dépité par son insuccès quasi complet à faire entendre la vie du Christ, il en aurait pleuré des larmes amères sur les rives de l’Èbre, au point que la Vierge elle-même serait venue en une apparition l’apaiser et l’encourager à la persévérance. S’il n’atteint pas ce but en ce monde, le fait d’être, comme Pierre, une des figures de la première Église de Jérusalem lui vaudra d’être pris pour cible par Hérode Agrippa et décapité en exemple, vers l’an 41. C’est son sang versé et sa dépouille mortelle qui portèrent du fruit comme le grain tombé en terre, mais pas avant une longue germination jusqu’en l’an 813 ! Au Campus Stellae, un champ montré par une étoile, l’ermite Pelage fut guidé jusqu’à la tombe de saint Jacques. Il y a eu une première église, un premier monastère et aujourd’hui Saint-Jacques de Compostelle est un pèlerinage qui touche largement croyants comme incroyants.
Jésus appelait Jacques et Jean « fils du tonnerre » (cf. Mc 3, 17). L’un écrivit la trace de l’éclair passé dans sa vie, l’autre marcha et fait désormais marcher vers lui, ou plutôt vers l’inoubliable éclair qu’est la rencontre de Dieu dans la vie humaine.
Fleur Nabert
Sculpteur. Réalise également du mobilier liturgique. Écrit sur l’art dans plusieurs revues dont Magnificat.
Saint Jacques (1520), Jacopo Sansovino (1486-1570), église Santa Maria di Montserrato, Rome. © akg-images / Andrea Jemolo.







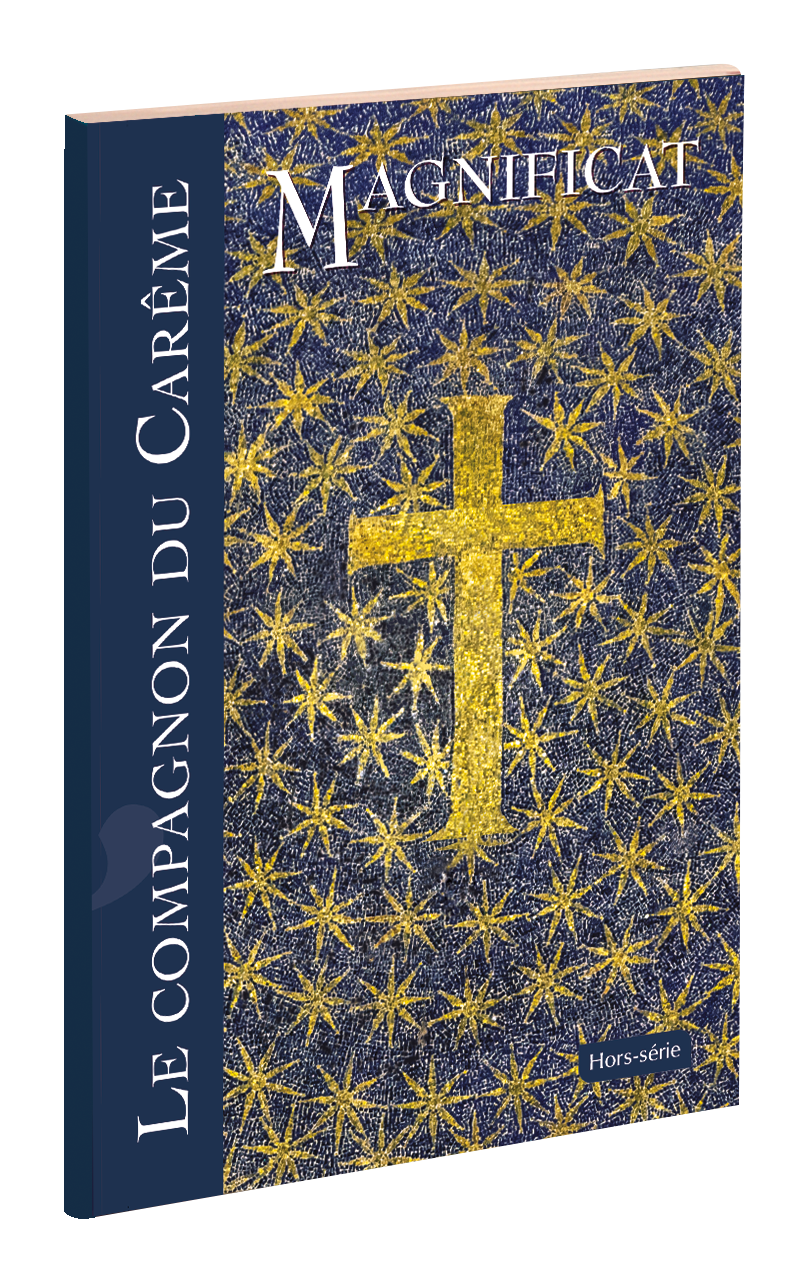
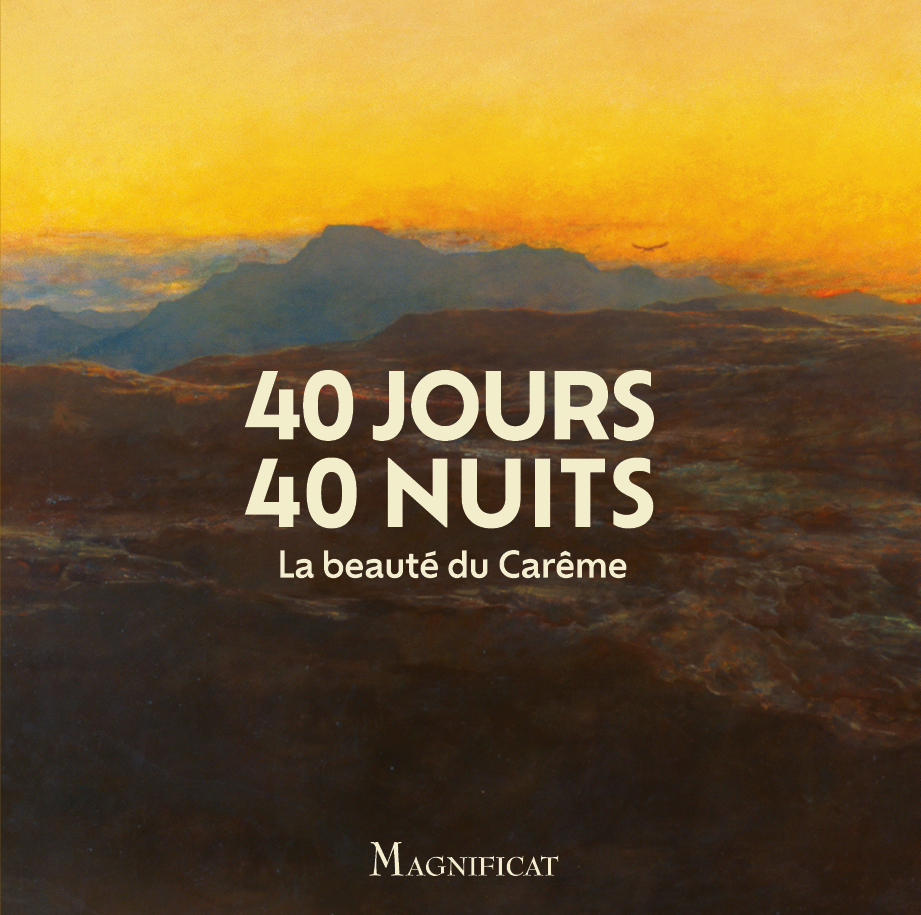


Autres commentaires