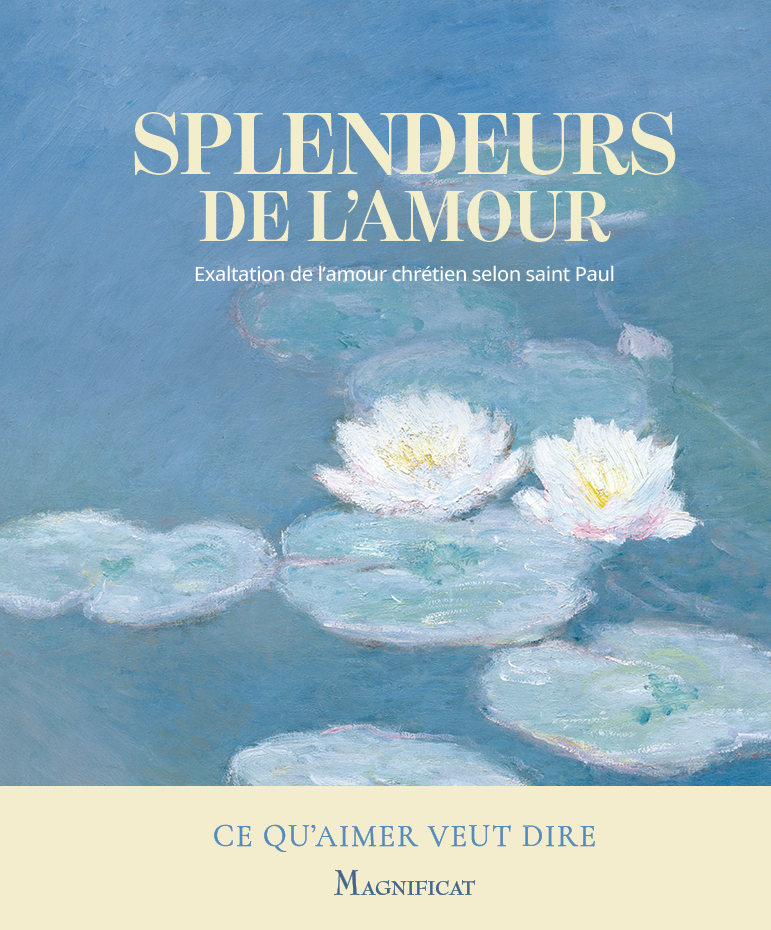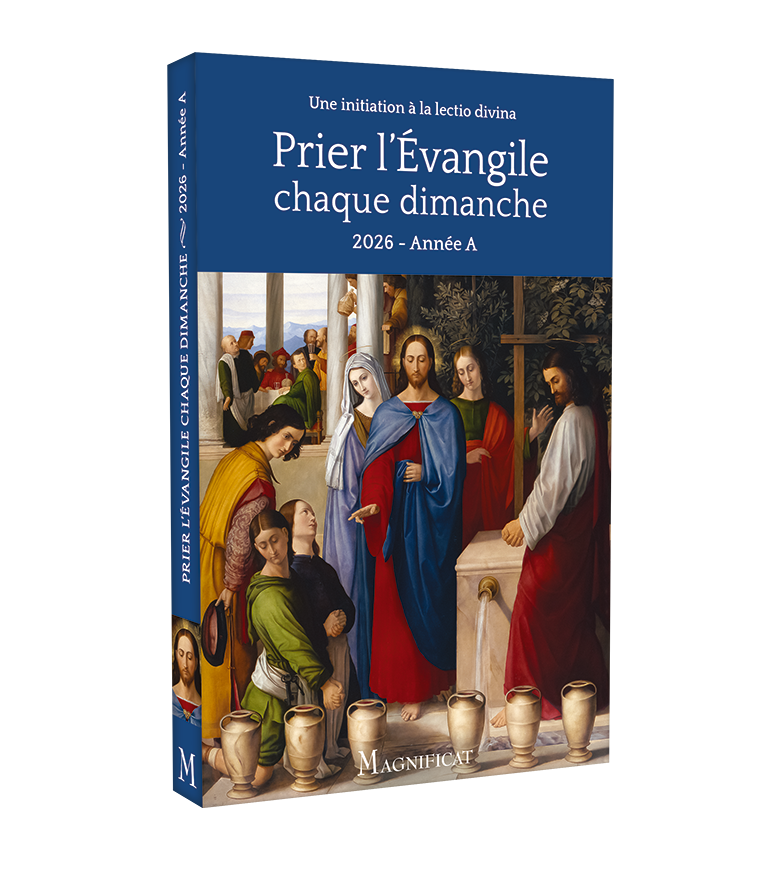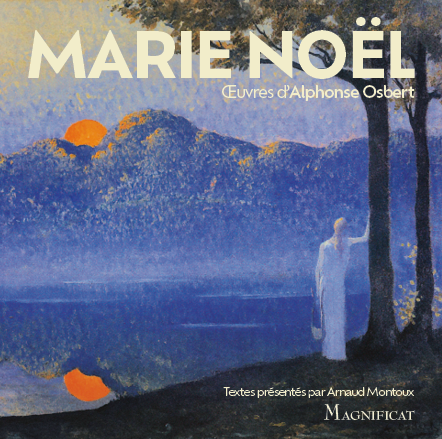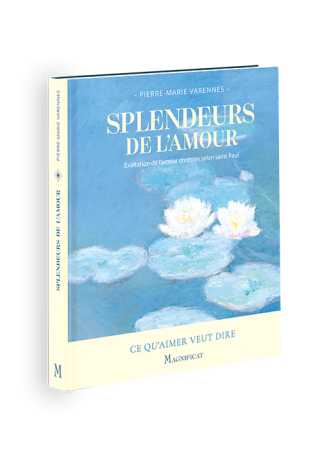L’été n’est pas un moment comme les autres. Certains partent en vacances, d’autres restent, mais pour la plupart, la pression du travail quotidien retombe, le rapport aux autres change. Tout semble plus léger dans la longueur du jour qui donne envie d’être dehors pour profiter de la lumière et de la douceur, pour s’ouvrir aux autres, échanger et découvrir d’autres mondes que le sien.
Magnificat vous propose de partir en voyage avec pour guides les saints. Ouvrir une petite fenêtre sur les lieux où ils ont vécu, là où Dieu les a envoyés en mission, là où il les a appelés à le servir ; découvrir leur environnement ; partager avec eux la sensation des paysages, des monuments, des églises qu’ils ont vus, traversés, aimés.
Nous pensons particulièrement à tous nos lecteurs qui ne se déplaceront pas cet été, parce qu’ils sont malades, âgés, hospitalisés, incapables de se déplacer, en situation trop précaire pour partir, ou parfois en prison. Tous ont besoin d’un peu d’évasion du cœur pour continuer d’avancer sur le chemin qui est le leur.
Le Seigneur nous l’a promis : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos » (Mt 11, 28). Que nous soyons en vacances ou non, allons au Christ par le chemin du cœur en suivant ceux qui ont tout donné pour être avec lui et trouver le repos de l’âme, qui est le bien le plus précieux. Déposons le fardeau, fermons les yeux et partons en voyage !
Le mont Carmel
Ici, pas de cathédrale, pas de monastère ; pour seul toit, le ciel embrasé ; pour uniques murs, des pins odorants, des oliviers et des lauriers fleuris agités par le vent. Le mont Carmel dont le nom, Har Hakkarmel, signifie littéralement « le vignoble de Dieu », est un promontoire rocheux qui s’avance dans la Méditerranée comme un doigt pointé depuis les monts de Samarie pour rompre la courbe du rivage et attirer l’attention.
Outre sa végétation luxuriante, le Carmel a la particularité d’être percé de nombreuses grottes qui, au fil du temps, ont servi de repaires aux brigands autant que d’abris pour les assoiffés de Dieu. Le prophète Élie, par son zèle ardent pour Dieu, a fait la renommée du Carmel, encore appelé Djebel Mar Elias, la montagne d’Élie. Sa statue domine le site d’el-Muhraka où il défia des prêtres de Baal au temps du roi Acab et de sa détestable épouse, Jézabel (cf. 1 R 18, 20-40).
Dans le cadre presque paradisiaque du Carmel, la figure d’Élie tranche. Il est l’homme de l’amour jaloux, de la foi pure, de l’exigence de la fidélité. Aucune mollesse ni compromission chez cet homme de Dieu. Profitant des grottes hospitalières du Carmel, des chrétiens ont voulu vivre comme Élie, dans la solitude et la radicalité d’un appel exigeant. Ce n’est qu’au xiiie siècle qu’une règle les rassemble et les invite à se tenir « dans leur cellule ou près d’elle, méditant jour et nuit la loi du Seigneur et veillant dans la prière ». Il n’est sans doute pas anodin que leur première église ait été placée sous le vocable de Marie qui, mieux encore qu’Élie, a su méditer jour et nuit la parole de Dieu.
La Cappadoce
Grâce aux saints Grégoire de Nysse, Grégoire de Nazianze, Pierre de Sébaste, Basile de Césarée, nous connaissons le nom de villes qui ont disparu ou perdu de leur importance et dont la plupart ont changé de nom au cours des siècles. Mais toutes ces villes antiques ont bel et bien été le siège d’une chrétienté vivante au cœur de l’actuelle Turquie, dans sa partie centrale, la Cappadoce. Merveilleuse région montagneuse située aux abords des monts Taurus, percée de grottes accueillant des églises troglodytes, parsemée de curiosités géologiques sculptées par le vent, l’eau et le froid.
Paul a longé et même traversé ses régions au cours de ses nombreux voyages. Césarée (aujourd’hui Kayseri) constitue le centre géographique autour duquel Nysse, Nazianze et Sébaste (aujourd’hui Sivas) rayonnent. Les liens sont étroits entre ces différentes Églises du IVe siècle.
La famille de Macrine, fêtée aujourd’hui, est restée attachée à cette terre insolite et propice à l’admiration de la grandeur de Dieu. À l’image de la nature qui se laisse travailler encore et encore jusqu’à produire de semblables richesses, Macrine et ses frères se sont livrés à la miséricorde de Dieu, le laissant faire son œuvre de grâce dans leur cœur. Évêque de Césarée, Basile a contribué à la réflexion théologique sur l’Esprit Saint et Grégoire, évêque de Nysse, laisse des écrits marqués par l’ascétisme inculqué par Macrine. Puissions-nous, en contemplant ces terres rudes, nous laisser saisir par l’amour du Christ.
La Suède
Brigitte est, elle aussi, patronne de l’Europe, aux côtés de Benoît. L’un s’ancra dans la stabilité d’un lieu. L’autre sillonna l’Europe, son bâton de pèlerin à la main. Un seul motif à leurs vies : chercher Dieu. Quel meilleur motif pour entreprendre un voyage qui, s’il passe par la pérégrination, n’en demeure pas moins intérieur ?
Née sur les terres fertiles de l’Uppland, centre politique et culturel de la Suède, Brigitte évolue dans la bonne société, proche du pouvoir royal, où elle rencontre celui qui sera son époux, le chevalier Ulf Gudmarson, dont elle aura huit enfants. L’un et l’autre sont profondément chrétiens et n’hésitent pas à partir en pèlerinage dans leur patrie, mais aussi jusqu’à Compostelle. Ce « champ des étoiles » situé à l’autre bout de l’Europe les attire. Ulf en revient malade et meurt. Brigitte n’en continue pas moins de marcher vers Rome où elle s’installe pour vingt ans, puis vers la Terre sainte. Les yeux de Brigitte s’emplissent de la beauté du monde qu’elle traverse. Des neiges de son pays natal au désert de Judée, combien de monts et de collines, de plaine et de bois, de rivières et de mers n’a-t-elle pas franchis ? Quelle profusion dans les œuvres du Seigneur ! Quelle profusion dans la vie de Brigitte qui contemple en son âme la splendeur du Sauveur qui est toute sa joie !
Mystique reconnue et écoutée, Brigitte a renoncé à tous ses privilèges pour vivre pauvre. Qu’elle nous enseigne l’art de marcher sur le bon chemin pour faire de notre vie un poème qui soit agréable à Dieu.
Compostelle
Quel contraste entre l’aridité du camino et la richesse du centre de Compostelle ! Tout est de pierre ici, du pavement des places et des ruelles jusqu’aux corniches des maisons. Tout un enchevêtrement de bâtiments – couvents, monastères, églises, palais – fait surgir de charmantes places où il fait bon s’arrêter.
Mais ce n’est pas le charme de la ville qui attire le pèlerin, c’est l’Apôtre Jacques. Et pour le rencontrer en vénérant ses reliques, il suffit de se rendre au gré des ruelles jusqu’à l’imposante cathédrale. Inutile de se laisser arrêter par l’exubérance de la façade baroque. Une surprise nous attend derrière : la magnifique façade romane avec son porche de la Gloire où le Christ plein d’humanité montre ses plaies. Sur le pilier central, saint Jacques, assis, nous accueille. À ses pieds, une main creusée dans la pierre invite les pèlerins fatigués à y poser la leur : ici, le but est atteint !
Tout dans la cathédrale dispose à la paix, l’élégance de l’architecture romane comme la douceur de la lumière. C’est à pas feutrés que l’on s’avance vers le tombeau de saint Jacques placé dans une étroite crypte sous le maître-autel. Après un si long voyage, comme il paraît court l’instant passé près de la châsse contenant les reliques de l’Apôtre. Court comme la soudaineté d’un appel. Court comme un « oui » donné sans retour.
La marche a creusé le désir, le repos l’a comblé. Il faut simplement repartir, par un autre chemin.
Béthanie
De l’esplanade du Temple, le chemin traverse la vallée du Cédron puis grimpe sur le mont des Oliviers. Encore quelques kilomètres, la route tourne sur la gauche, on aperçoit la dépression de Jéricho, là est Béthanie. Ou plutôt, là était Béthanie car du village originel, il ne reste rien.
On est un peu étonné d’entrer dans un village portant le nom de al-Azariyeh – le lieu de Lazare. « Où est-elle, Marthe, ton accueillante maison ? » Nul ne saurait le dire.
Il faut bien avouer que depuis la plus haute antiquité, c’est le sépulcre de Lazare qui concentre l’attention des pèlerins. Au ive siècle, une église était déjà construite sur la tombe. La pèlerine Égérie (aussi appelée Éthérie) raconte : « L’archidiacre élève la voix et dit : “Que tout le monde soit là aujourd’hui à la 7e heure au Lazarium.” Le Lazarium, c’est-à-dire Béthanie, est à peu près au deuxième mille de la ville. Quand on va de Jérusalem au Lazarium, à peu près à cinq cents pas de cet endroit, il y a une église sur la route, là où vint au-devant du Seigneur, Marie, sœur de Lazare.» C’est bien plus tard, au Moyen Âge, que la maison de Marthe apparaît dans les « guides touristiques » de l’époque, car forcément elle est proche de la tombe.
Une église puis une autre, un monastère puis une mosquée et à nouveau une église. Telle est la réalité des lieux saints. Un empilement de traditions qui s’appuient sur une permanence de prière au long des siècles. Nous sommes là, nous aussi, humant l’air de ce village où monte l’odeur d’une cuisine, Marthe n’est pas loin, Jésus non plus. La chaleur nous donne envie de nous arrêter, l’église comme un havre de paix nous ouvre ses portes. Dans la douceur de sa maison, comme Marthe, accueillons le Christ qui vient à nous.
Voyageur de Dieu
Loiola – Loyola – est un quartier d’une petite ville du Pays basque espagnol, Azpeitia, non loin de San Sebastián. C’est là qu’Iñigo voit le jour. Ce coin de terre, entre mer et montagne, ne sera bientôt qu’un point fixe dans la vie pérégrinante d’Iñigo. Il faut le suivre à la cour du roi d’Aragon, puis dans les armées du royaume de Castille et finalement au siège de Pampelune, qui met un premier arrêt à ses déambulations.
C’est le début d’une conversion intérieure qui va l’engager à se faire pèlerin. De Loyola à Montserrat, puis à Barcelone et finalement dans le village de Manresa – Manrèse. Dans ce lieu retiré, il s’adonne à la plus grande ascèse et commence la rédaction des Exercices spirituels, prototype du voyage intérieur.
Mais bientôt, il repart pour Jérusalem, puis retour à Barcelone où il commence un autre voyage, celui des études, qui durera onze ans et le conduira à Salamanque et enfin à Paris. Il y rencontre ses premiers compagnons, hommes de valeur séduits par sa personnalité. Ils sont sept, prémices de la Compagnie de Jésus, à prononcer leurs vœux dans la crypte des martyrs au pied de Montmartre. Dans le but de se rendre en Terre sainte, Iñigo les précède à Venise où, avec d’autres compagnons, il est ordonné prêtre. Ils n’iront finalement pas à Jérusalem, mais à Rome. C’est là qu’il prend le nom d’Ignatius – Ignace –, là qu’il envoie ses compagnons aux quatre coins du monde, là qu’il achève sa vie.
Puissions-nous, à son exemple, être toujours prêts à suivre le Christ là où il nous veut, fût-ce dans un voyage intérieur.
©MGF no 320, Juillet 2019