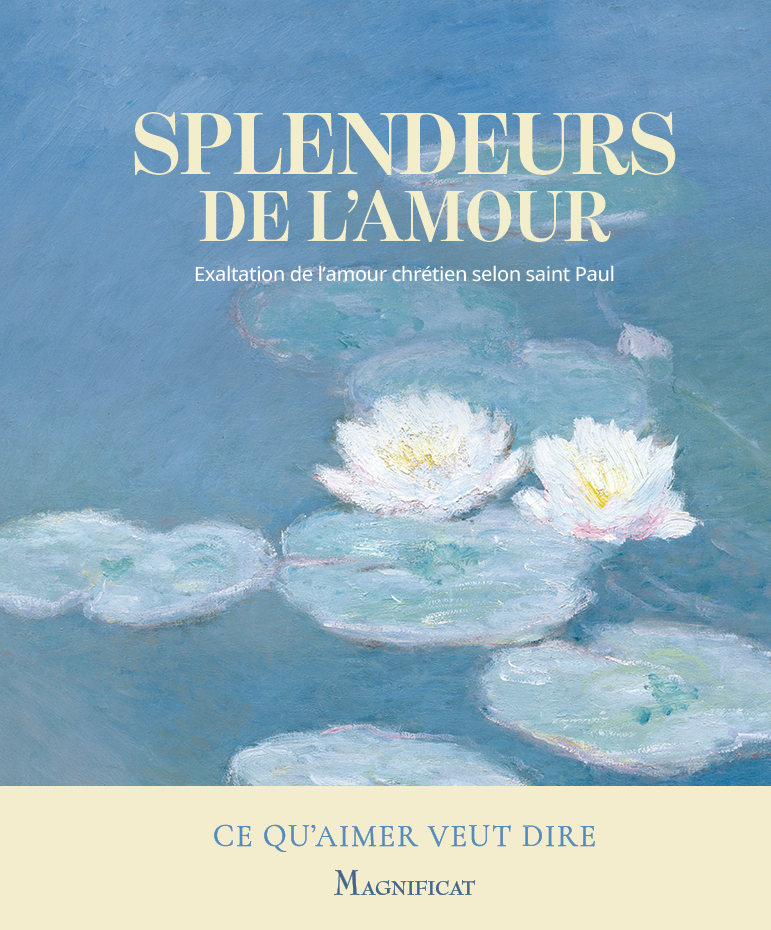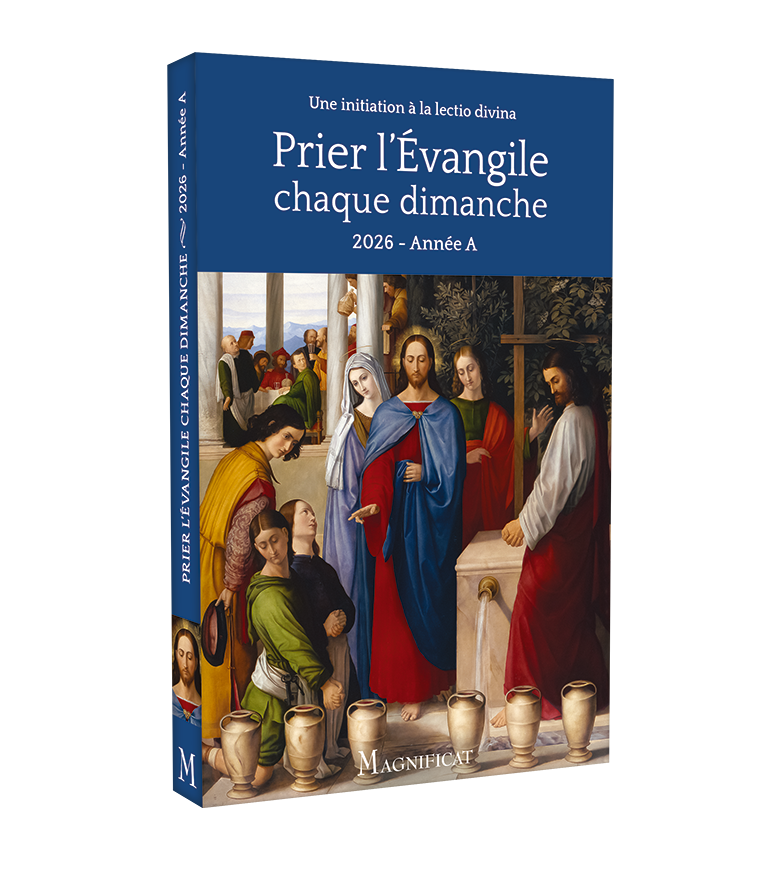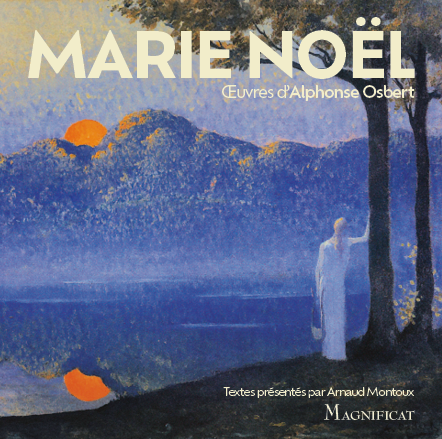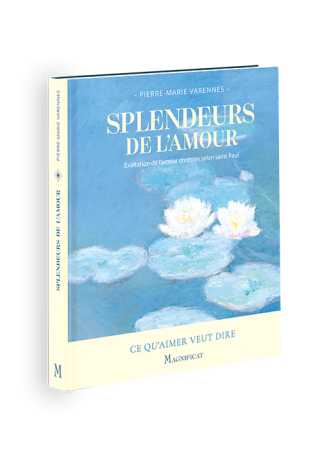C’est à la fin du concile de Nicée (325) que l’évêque de Jérusalem, Macaire, demanda à l’empereur Constantin la permission de pratiquer des fouilles sur les lieux de la crucifixion et de la sépulture du Seigneur, dont la Tradition avait conservé le souvenir. Ce n’était pas si simple, car l’empereur Hadrien, au début du IIe siècle, avait fait niveler les lieux pour y bâtir une esplanade surmontée d’un temple de Vénus – sans doute dans l’intention d’effacer déjà les souvenirs chrétiens. Après d’énormes travaux, on retrouva le rocher du Golgotha et la grotte du Saint-Sépulcre ; Constantin fit construire sur cet emplacement une rotonde abritant le tombeau du Christ, ainsi qu’un sanctuaire à l’emplacement du Golgotha, le tout relié par de vastes portiques. La mère de l’empereur, Hélène, était venue elle-même à Jérusalem ; elle avait de son côté fait pratiquer des fouilles sur le mont des Oliviers et à Bethléem, où un sanctuaire d’Adonis avait de même recouvert la grotte de la Nativité. En 335, on pouvait procéder à la dédicace de la basilique de la Résurrection ; l’évêque Eusèbe de Césarée, le premier historien de l’Église, par lequel nous connaissons un certain nombre de ces événements, prononça pour l’occasion un grand discours dont il se montra assez satisfait, à ses dires. Mais il ne dit rien de la découverte du bois de la croix.
L’invention de la Sainte Croix
Pour autant que l’on puisse démêler des récits contradictoires, l’« invention », c’est-à-dire la découverte du bois de la croix du Seigneur se produisit, sur ces entrefaites, dans une citerne située à peu de distance ; le poteau portait encore, dit l’une des traditions, le titulus, c’est-à-dire l’écriteau placé par Pilate, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quoi qu’il en soit, l’évêque Cyrille de Jérusalem parle déjà, en 347, dans ses catéchèses baptismales des fragments de la croix que l’on distribuait dans le monde entier… Des fragments importants furent envoyés à Constantinople et à Rome, où l’empereur Constantin fit construire la basilique Sainte-Croix-de-Jérusalem en souvenir de sa mère, décédée peu après son pèlerinage en Terre sainte. À Jérusalem, naturellement, on célébrait la découverte de la croix avec beaucoup de faste. Une religieuse des Gaules, Éthérie (Égérie), qui fit le voyage à Jérusalem vers la fin du IVe siècle, nous a laissé un récit passionnant des liturgies auxquelles elle avait assisté : c’est elle qui nous explique que l’on fête solennellement la croix du Seigneur en même temps que la dédicace de la basilique de la Résurrection, le 14 septembre. La fête passa ensuite à Constantinople, puis à Rome au temps du pape Serge Ier (687-701). C’est l’origine de notre fête de la « Croix glorieuse ».
La liturgie de Jérusalem
Les liturgies qui se déroulaient « sur les lieux » à Jérusalem, qui avaient tant impressionné notre pèlerine Éthérie, passèrent, elles aussi, petit à petit dans les liturgies orientales et occidentales, en particulier celles de la Semaine sainte : c’est le cas de notre procession des Rameaux, et encore de la vénération de la croix du Vendredi saint. Les hymnes latines du temps de la Passion se rattachent aussi aux reliques de la croix. En 569, l’empereur byzantin Justin II envoya à sainte Radegonde un fragment du bois de la croix conservé à Constantinople – la relique et le magnifique reliquaire qui la contenait existent toujours, au monastère Sainte-Croix, près de Poitiers. C’est à l’occasion de la réception de la relique que Venance Fortunat, alors prêtre attaché au monastère, composa plusieurs hymnes, dont le Vexilla Regis que nous chantons encore aux vêpres du temps de la Passion, et le Pange lingua […] certaminis qui figure dans la liturgie du Vendredi saint.
Tout cela nous conduit, symboliquement, à Jérusalem ; la situation des chrétiens de Terre sainte est aujourd’hui bien difficile, du fait de l’interruption prolongée qu’ont subi les pèlerinages. Que ces célébrations nées à l’ombre des Lieux saints nous incitent à ne pas oublier dans notre prière ceux qui y vivent aujourd’hui.
©MGF no 358, Septembre 2022