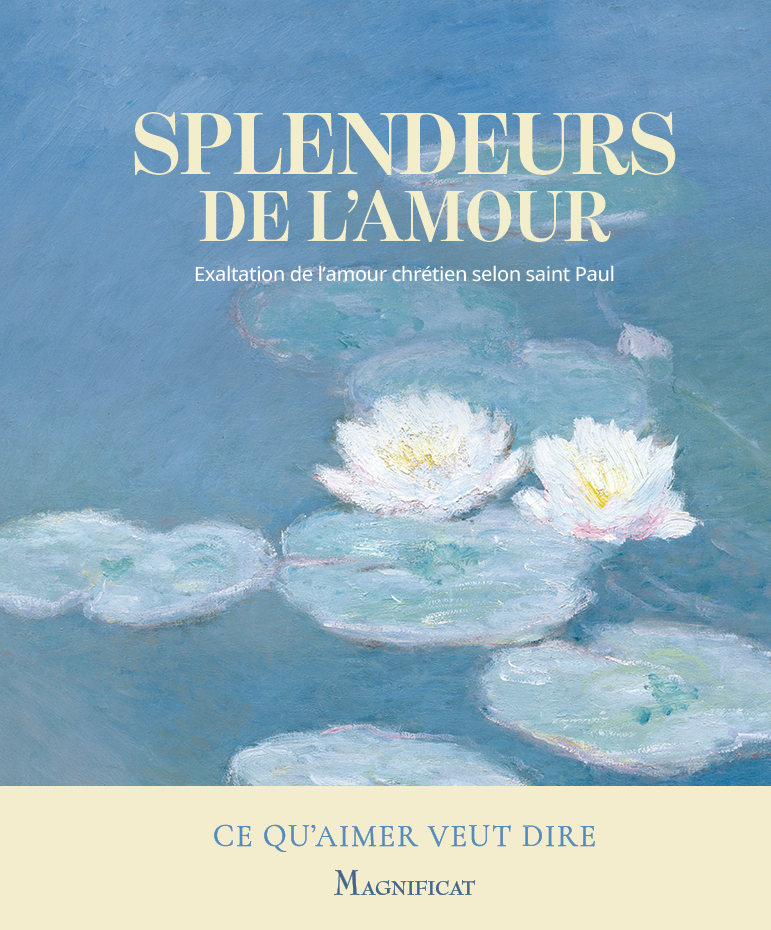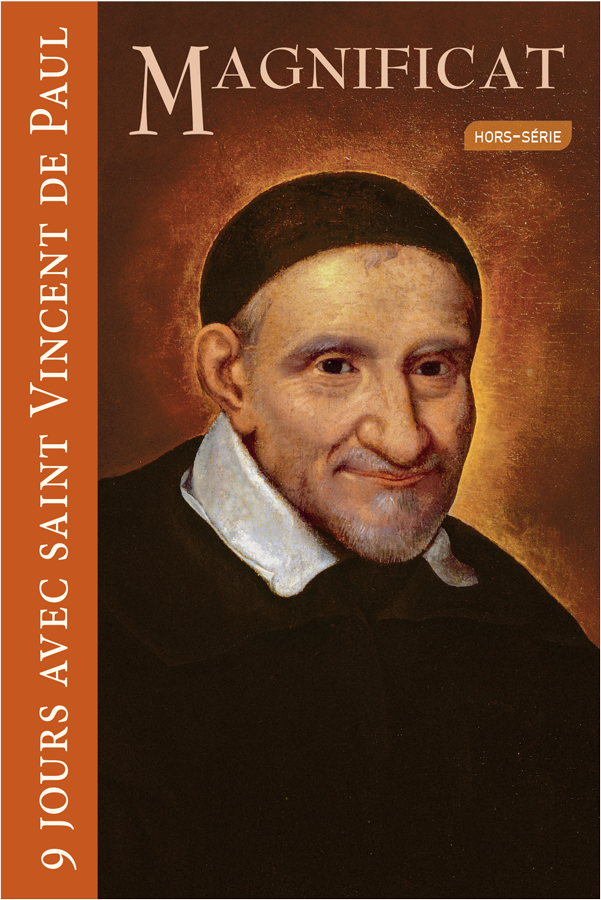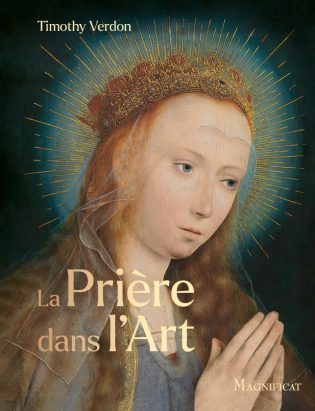Quand nous débutons le Carême, combien d’entre nous s’y engagent à reculons ? Nos nécessaires conversions vont nous conduire à une certaine forme d’introspection et, souhaitons-le, au travail méticuleux du potier qui reprend tel ou tel défaut de son ouvrage. Cette approche pénitentielle est clairement annoncée dès la prière sur les offrandes du mercredi des Cendres : « Seigneur[,] fais que, par des actes de pénitence et de charité, nous évitions tout plaisir mauvais, et que, purifiés de nos péchés, nous méritions de célébrer avec ferveur la passion de ton Fils. » La dimension pénitentielle est indiscutablement inhérente au Carême mais il ne faudrait pas non plus qu’elle voile d’autres aspects de ce temps liturgique. Cette approche, qui peut éventuellement sombrer dans l’égocentrisme, doit se laisser interroger à la fois par le sens originaire de ce temps et la couleur que commencent à prendre ces quarante jours dans la plupart de nos communautés paroissiales aujourd’hui.
Le catéchuménat teinte le Carême
Plus les années passent, plus les catéchumènes (adultes se préparant aux sacrements du baptême, de la confirmation et de l’eucharistie) sont au cœur de la liturgie du Carême. Avec joie, nous les voyons debout et à genoux au cœur de nos communautés chrétiennes vivant, par exemple, les étapes des scrutins : tout en priant que Dieu les assiste dans cette ultime étape, nous demandons en même temps – nous, « vieux baptisés » – la grâce d’être à la hauteur de leur conception de la vie chrétienne. Leur conversion encourage la nôtre.
Il faut bien le constater : le Rituel de l’initiation chrétienne des adultes, publié en 1996 dans les pays francophones, vient profondément teinter de manière nouvelle nos célébrations de Carême. On pourrait même aller jusqu’à dire que ce rituel vient percuter l’unique approche pénitentielle du Carême véhiculée ces derniers siècles par la liturgie qui n’avait pas à prendre en compte les démarches actuelles de ces adultes demandant le baptême. L’Église, dans sa longue sagesse de l’œuvre liturgique, avec le temps, va s’adapter. Il faut simplement que nous en prenions conscience : du fait de l’importance que prend le catéchuménat dans nos diocèses, nous sommes invités aujourd’hui à réfléchir à frais nouveaux à l’objectif du Carême dans la vie de notre Église.
Les raisons primitives du Carême
Pour nous y aider, il y a intérêt à retrouver le sens initial des choses en nous penchant sur les raisons pour lesquelles nos Pères ont instauré ce temps du Carême. Au ive siècle, les objectifs des quarante jours précédant Pâques sont clairs : instruire les adultes demandant à devenir chrétiens lors de la prochaine vigile pascale et préparer la communauté chrétienne à les recevoir. Ce sont les raisons principales de la mise en place du Carême. Avant cette période d’explosion du nombre de chrétiens, les baptisés se préparaient à la fête de Pâques principalement par la pratique du jeûne dans les jours qui précédaient.
C’est le nombre important des demandeurs du baptême qui a obligé l’Église à s’organiser autrement et à concevoir un temps d’ultime préparation qui donnera naissance à notre Carême : cela se déclinera sous l’aspect catéchétique, ascétique et liturgique. Autrement dit, on peut affirmer que les évêques se chargeaient alors de l’enseignement quotidien des catéchumènes, puis ils les encourageaient à se purifier par des jeûnes multiples et priaient sur eux par le moyen d’exorcismes et d’onctions d’huile consacrée. Ce qui est très intéressant, c’est que dans différents témoignages de cette période, nous voyons que l’ensemble de la communauté chrétienne était invité à se joindre à cette triple démarche. Ce n’était pas que l’affaire de l’évêque et de ses catéchumènes.
Trois objectifs communautaires
Travailler aujourd’hui à recevoir de manière nouvelle le temps liturgique du Carême pourrait aider nos paroisses à se réapproprier trois dimensions originelles et capitales.
D’abord la dimension catéchétique. Les remontées des derniers synodes diocésains ou du synode universel sont unanimes pour affirmer que nous avons tous besoin de recevoir une formation plus solide et adaptée aux conditions actuelles de la vie chrétienne. On sait cependant que l’on offre régulièrement des formations mais que les demandeurs se déplacent peu. Pourquoi, dans ce cas, ne pas retrouver l’une des fonctions initiales du Carême en recentrant sur cette période notre formation chrétienne et en y associant nos catéchumènes ? On pourrait ainsi faire de la catéchèse pour adultes un effort commun de Carême.
Deuxièmement, la dimension de la fécondité de l’Église. Le pape François ne cesse de rappeler que « l’essence même de l’Église est de faire des enfants ». Mettre le catéchuménat au cœur de la vie liturgique du Carême permet de se recentrer aussi sur notre devoir de fécondité commune. Oui l’Évangile du Christ a de l’avenir !
Troisièmement enfin, les parcours souvent atypiques des catéchumènes sont la preuve que Dieu nous appelle et conduit nos vies par pure miséricorde. Ce ne sont pas ni mon propre mérite ni mes exercices pénitentiels qui me sauvent en premier lieu mais la pure et gratuite miséricorde du Père. Certes, nous sommes conviés à pratiquer une véritable ascèse dans bien des domaines de nos vies (médisance, nourriture, utilisation des téléphones portables, addictions diverses et variées, etc.) mais Dieu désire avant tout la miséricorde plutôt que les sacrifices (cf. Mt 9, 13 ; 12, 7 ; Os 6, 6). Dit de manière différente : les actes de pénitence porteront du fruit s’ils sont d’abord issus d’une véritable louange au Père des miséricordes.
Redécouvrir le Carême comme un temps de formation communautaire est un enjeu pour les années qui viennent.
Article paru sous le titre « Formation communautaire » dans MGF no 363, février 2023